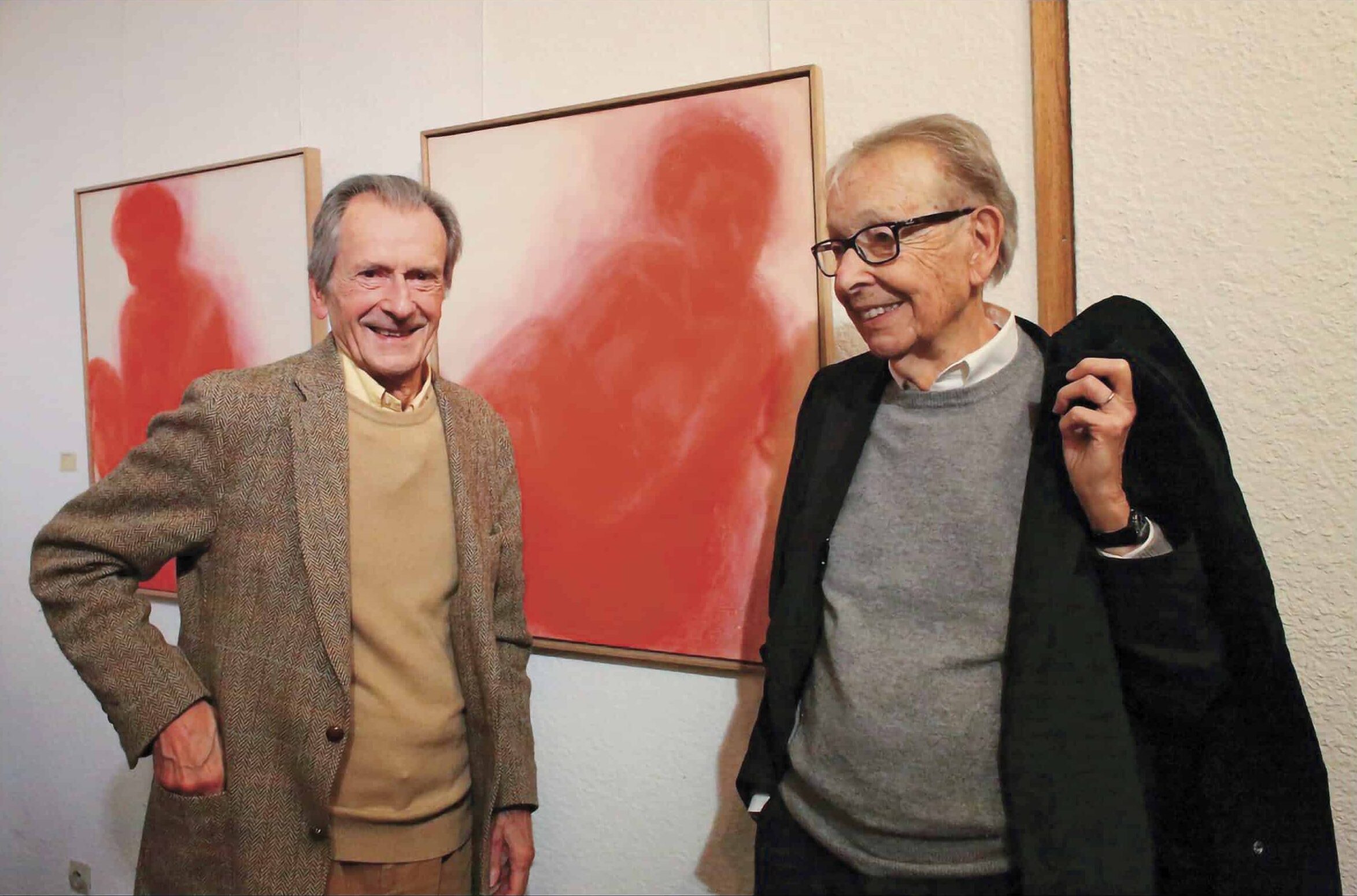Consacrée le 20 octobre 1275 en présence du pape Grégoire X et du roi des Romains Rodolphe Ier, la cathédrale de Lausanne est un «lieu phare» de l’Eglise évangélique réformée vaudoise. Chef-d’œuvre gothique, l’édifice passé à la Réforme en 1536 est à la fois un lieu de culte, de culture et d’histoire.

«Il n’y a pas besoin de dire aux enfants de faire silence: ils se taisent d’emblée en entrant, ébahis par la majestuosité du lieu.» Cela fait plus de quinze ans que Floriane Nikles propose aux tout-petits (dès 3 ans) des promenades gratuites à la découverte de Lausanne – programme depuis étendu aux enfants jusqu’à 10 ans et aux adultes. Cette année, elle les amène à la cathédrale à la demande des organisateurs des festivités des 750 ans de la consécration de l’édifice qui domine la ville. «Pourtant, nuance-t-elle, il joue à cache-cache avec nous. On ne le voit pas de partout. Mais lorsqu’il se montre, il y a des perspectives extraordinaires, par exemple depuis la promenade de la Solitude où on le voit dans sa verticalité avec le chevet et la tour-lanterne.»
C’est au-dessous de cette dernière que la Lausannoise parle de la cathédrale. Avec sa flèche qui culmine à près de 80 mètres au-dessus du sol, elle en est la partie la plus haute: «Un des buts d’une cathédrale est de toucher symboliquement le ciel, et c’est ce point qui s’en approche le plus».
Un lieu ouvert
La cathédrale vient d’ouvrir ses portes aux visiteurs – près de 490’000 en 2024 – ce matin d’août. Certains photographient la nef ou la rose, d’autres se promènent le nez en l’air. «Aux petits, je montre des photos d’éléments qu’ils doivent retrouver. Aux plus grands, je parle du vocabulaire de la cathédrale, avec ses mots si beaux comme le narthex et le déambulatoire», explique-t-elle. Avant de conter sa surprise, un jour, face à la question d’une fillette de 3 ans: «Il est où Youzou?». «Elle voulait savoir où était Jésus. Cela m’a beaucoup touchée.»
Même si elle lutte pour le titre de premier site touristique romand avec la Maison Cailler à Broc (FR) et accueille des manifestations culturelles et des événements politiques comme l’assermentation des autorités cantonales, la cathédrale est d’abord un édifice religieux. «Elle vit bien ces différents statuts», rassure Line Dépraz. Pasteure à la cathédrale depuis 2019, elle a aussi pour mission de «tisser des liens entre les questions sociétales, la culture et la spiritualité au sens large». Cela passe par des prêches dominicaux thématiques, des prédications partagées – avec des politiciens, des artistes, des représentants d’autres confessions – et des expositions et spectacles.

La sobriété de l’intérieur est en ce sens un avantage. «Cela permet à des personnes de sensibilités diverses de s’y sentir bien.» Peu de visiteurs restent indifférents, constate la pasteure qui passe beaucoup de temps dans la cathédrale – quelquefois seule hors des heures d’ouverture. «Il y a presque toujours un détail, une lumière, un espace qui émerveille. Parmi les personnes qui participent au culte – peu sont des paroissiens qui viennent tous les dimanches, il s’agit le plus souvent de personnes attirées par une thématique annoncée ou le lieu –, certaines ont leur place favorite, parfois liée à un vitrail ou un élément architectural.»
Depuis plusieurs mois, un jeune hindou prie régulièrement ses dieux dans la chapelle de Marie. «Il ne vit sans doute pas ce que je vis ni ce qu’ont vécu les chanoines, mais c’est beau qu’il se sente accueilli et vive quelque chose de sa spiritualité», se réjouit la pasteure. La présence d’une statuette de la Vierge depuis quelques années pourrait d’ailleurs étonner dans cet édifice protestant. «Des personnes y prient une figure maternelle et féminine importante et allument une bougie. Ce n’est effectivement pas très réformé, mais c’est très humain», souligne Line Dépraz en rappelant que la cathédrale a été consacrée à Notre-Dame.
Une histoire? Des histoires!


C’était donc il y a 750 ans. «Mais l’essentiel de la construction était achevé dans les années 1230. Toute la partie orientale, le transept et une large partie de la nef ont été construits entre 1170 et 1200 environ», annonce Karina Queijo, archiviste de la cathédrale. Avec fierté, car son collège archéologue Mathias Glaus a récemment pu déterminer, grâce à un fragment de bois datant de 1195/96, que les travaux avaient été effectués un quart de siècle plus tôt que jusqu’alors estimé. «Lausanne n’était donc pas en retard par rapport aux grands exemples français, comme Chartres, reconstruite à partir de 1194. Elle était tout à fait dans le mouvement de son époque.»
Bien des choses demeurent floues, faute de journal de chantier ou de comptes détaillés. On ignore par exemple ce que représentaient les vitraux – hormis la rose dont les verres sont pour la plupart d’origine. On se doute toutefois que de nombreuses choses ont changé: la cathédrale a été agrandie au début du 16esiècle en avalant la route qui séparait le fond de la nef des tours ouest et, surtout, les Bernois sont arrivés peu après. Leurs comptes montrent qu’après l’attribution de la cathédrale au culte réformé en 1536, ils ont payé pour faire badigeonner les murs et retirer du mobilier – les autels notamment. Mais ils étaient pragmatiques: les vitraux qu’il aurait été coûteux de remplacer sont conservés, ainsi que le jubé qui séparait la nef du chœur. L’ancien chœur sert d’auditoire à la faculté de théologie; dans la nef, on place des bancs et, au centre, une chaire. Remplacée en 1633, elle est très rarement utilisée depuis qu’on regarde à nouveau vers l’est et la table de communion. Line Dépraz n’y est montée qu’une fois et juge la chose «peu agréable parce qu’on est vraiment placé très au-dessus de l’assemblée».
De nouveaux vitraux figuratifs – les anciens verres cassés avaient progressivement été remplacés par des carreaux neutres – apparaissent au 20e siècle. «On veut faire de la place aux artistes contemporains et valoriser la cathédrale. Il s’agit aussi de rester attractif, car les catholiques, dont le culte est autorisé depuis le 19e siècle, disposent d’églises modernes et plus confortables», commente Karina Queijo.
L’historienne de l’art évoque encore le portail ouest, entrée actuelle de la cathédrale. Lorsque les restaurateurs le remplacent par une copie en calcaire, plus résistant que la molasse, vers 1900, ils ajoutent le trumeau supposément détruit par les Bernois, qui avaient entre autres fondu la statue miraculeuse de la Vierge. Sur ce pilier central, il en faut une, de statue. La Vierge? Impensable pour des réformés! Une incarnation de l’Evangile? Elle ressemble trop à la Vierge… Le trumeau reste ainsi vide, malgré des réclamations en 2016 encore. «Les restaurateurs ont cru bien faire, mais ils ont inventé un trumeau qui n’a en réalité jamais existé», comme le démontrent des documents publiés en 1906 déjà, s’amuse Karina Queijo.
S’il ne porte pas de statue, le trumeau est ainsi, en revanche, porteur d’une histoire. Celle que continuent d’écrire en chœur les pierres et les pierres vivantes de cette cathédrale chère aux Lausannois et aux Vaudois.