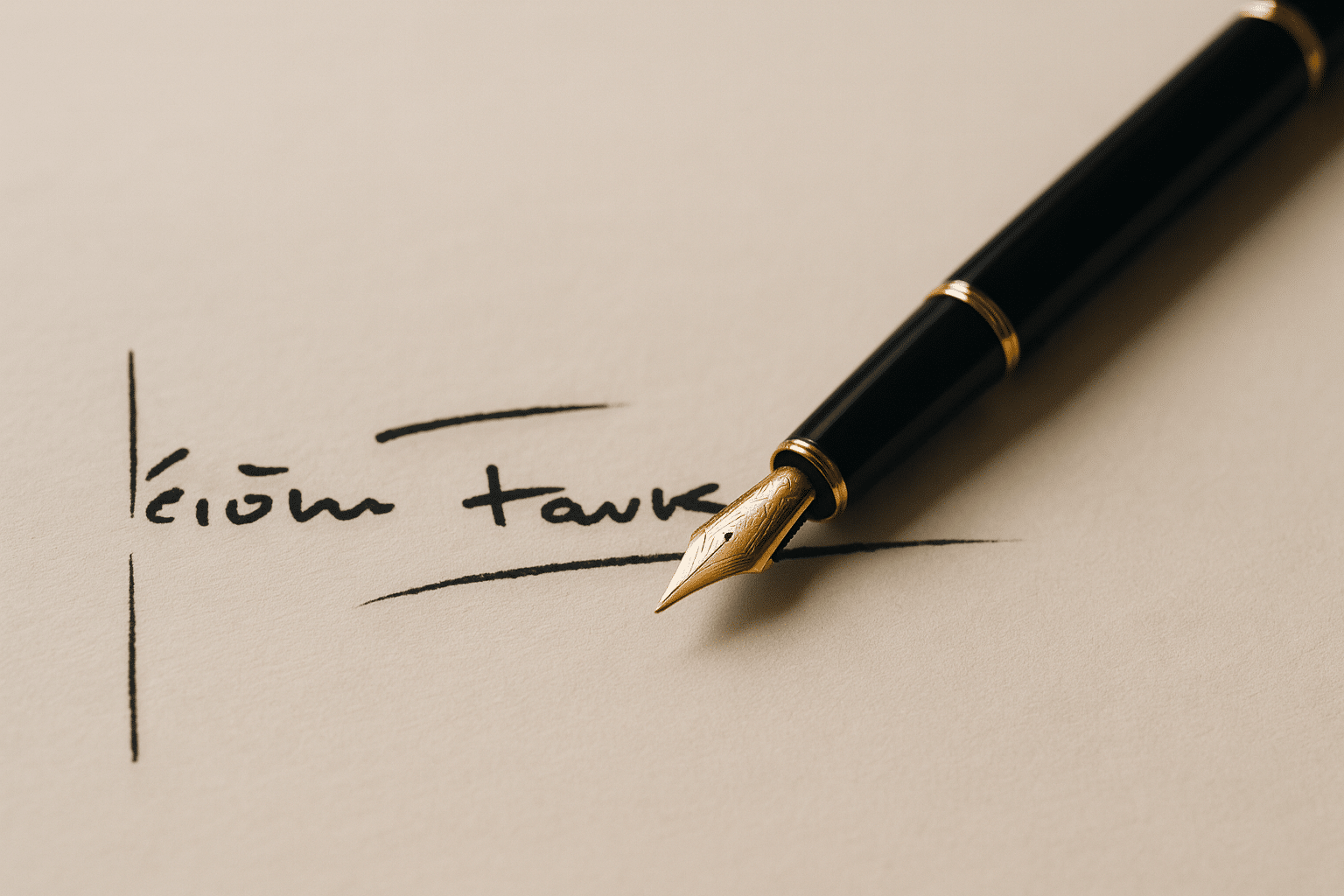A l’invitation du professeur de théologie Olivier Bauer, huit étudiants de l’Université de Lausanne et une de Genève se sont faits pèlerins pour étudier le pèlerinage. Entre enseignement, visites de lieux de culte et méditation, ils ont marché de Lausanne au Grand-Saint-Bernard au début du mois.

«Depuis hier, nous avons des bâtons de pèlerin, ce qui nous identifie en tant que tels», glisse Olivier Bauer alors qu’il s’apprête à reprendre sa marche avec ses neuf étudiants. Il est 9 h 45 ce 12 septembre à Orsières (VS) lorsque le groupe, une fois les ingrédients de la fondue du soir répartis dans les sacs à dos, prend la direction indiquée par un panneau jaune marqué du numéro d’itinéraire 70 et du logo de la Via Francigena.
«On ne peut pas étudier le pèlerinage de manière statique. Il faut bouger, l’expérimenter dans son corps», explique le professeur de théologie pratique en s’éloignant du village. Après cinq jours de marche et un jour de repos, les étudiants-pèlerins ont laissé Lausanne et leur université à près de cent kilomètres. Il leur en reste moins de trente à parcourir pour atteindre l’hospice du Grand-Saint-Bernard, le but qu’ils se sont fixé. «Contrairement à la marche spirituelle où on choisit des paysages qui nous inspirent, que ce soit une rivière, un désert ou la montagne, le pèlerinage chrétien, hindou ou bouddhiste suppose une destination, un lieu sacré par exemple», rappelle Olivier Bauer. Si le Grand-Saint-Bernard et son col situé à près de 2500 mètres d’altitude ne sont en principe qu’une étape sur le chemin de Rome à Cantorbéry dont l’évêque Sigéric a relevé le tracé en 990, ils constituent un bon point d’arrivée pour les dix universitaires. En plus de son aura spirituelle, le lieu représente à la fois un passage, notion importante dans un pèlerinage, et un aboutissement, à la fin de la partie suisse de la Via Francigena.
Une expérience à vivre

Sur la route de Liddes et de Bourg-Saint-Pierre, tantôt asphaltée tantôt forestière, les discussions vont bon train. «Dans les moments où le groupe est plus compact, on échange. Cela permet de s’ouvrir aux perspectives et aux idées des autres. Ce sont aussi des moments très forts», témoigne Julianne, 20 ans. L’étudiante en théologie et en lettres n’avait jamais vécu pareille expérience. Elle évoque la perception du temps qui diffère lors des étapes, où il passe plus rapidement, et sur le chemin où son rythme, plus lent, permet aussi, lorsque le groupe s’étire, «de se poser dans sa tête parce que l’effort physique ne demande pas de concentration particulière et favorise la réflexion».
«Le pèlerinage est une expérience tellement particulière aux niveaux humain, physique, religieux ou spirituel qu’il est très difficile d’en parler sans l’avoir vécue», jauge Lidia, 20 ans également, étudiante en science des religions et en lettres. Quelques instants plus tôt, avant que le chemin n’épouse une pente plus raide, elle a lors d’une pause présenté au groupe une série d’articles sur l’anthropologie du pèlerinage. Dont certains l’ont parfois fait «grincer des dents», leurs auteurs n’ayant manifestement pas quitté leur bureau. «Je sentais une grande distance avec ce que j’avais vécu»: la jeune femme a marché cet été, avant ces lectures universitaires, les cent derniers kilomètres menant du Portugal à Saint-Jacques-de-Compostelle.
S’interrompant pour s’enquérir de la forme de deux collègues qui se sont arrêtés sur le bord du chemin, elle parle des points communs et des différences entre sa première expérience et ce cours-pèlerinage. Cet été, elle était partie seule et avait constitué au fil des rencontres un groupe dont elle restait toutefois indépendante; ici, «nous ne sommes pas tous là pour les mêmes raisons, nous ne nous connaissions pas il y a une semaine, mais la marche aplanit nos différences et nous formons une communauté». Son propre vécu n’est pas le même, du fait du contexte scientifique: «J’aimerais pouvoir dire quelque chose de cette expérience. Je prends donc aussi une distance de chercheuse pour observer ce qui se passe».
Une voie, plusieurs voix

Car il s’agit bien d’un enseignement universitaire, sous la forme d’une «observation participante», pour être précis. Les moments de spiritualité proposés peuvent être vécus intimement ou faire l’objet d’une étude d’une pratique spirituelle – comme en un trou de verdure et de pierres dégageant une certaine énergie ou lors de la visite de lieux de culte jalonnant le parcours.
Olivier Bauer apprécie cette méthode qui permet d’intégrer l’environnement dans l’enseignement. Un bref arrêt en bordure d’un chemin lui offre l’occasion de donner quelques indications sur l’impact de la spiritualité sur la géographie, des chapelles et des hameaux étant apparus le long des voies de pèlerinage. Le pèlerin ne quitte ainsi pas tout à fait ses frères humains. «C’est un grand débat, y compris chez les protestants sur la vocation du chrétien: doit-on se tenir à l’écart pour entretenir sa vie spirituelle ou le faire là où on vit?», commente le professeur de théologie pratique. Quelle que soit la réponse à cette question, le pèlerin doit s’arrêter quelque part de temps en temps. «Il fallait bien un monastère où se reposer, et une vie économique s’est développée tout autour, avec des foires notamment.»
Sans compter que les pèlerins ne se fraient pas une route dans un environnement vierge. «On se trouve ici sur l’ancienne voie romaine et gauloise, sur la route Napoléon, sur un chemin également indiqué comme un chemin de trail, constate le théologien protestant. Il y a plusieurs façons de suivre ce chemin.» L’exposition qui rendra compte de l’expérience des étudiants pourrait ainsi s’intituler, suggère-t-il, Nos Via Francigena. Parce que chacun y a «un rapport différent, même si nous marchons tous dans la même direction».
UNE FOI RENFORCÉE
Le pèlerinage est une thématique actuelle, souligne Olivier Bauer dont les étudiants s’interrogent aussi sur les différentes façons de vivre cette expérience. Actuellement en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle sur la partie espagnole du camino, Karin Baumgartner observe aussi cette diversité, entre la «beauté de la dévotion» des catholiques espagnols et la rencontre de marcheurs assurant rapidement n’être pas des personnes religieuses. «Certains viennent pour des raisons sportives ou pour visiter l’Europe, d’autres portent un deuil. Mais tous, d’une manière ou d’une autre, sont en quête de sens.»
Une ouverture à Dieu
Entraînée sur la voie de pèlerinage par une amie en 2021 avant d’y retourner chaque année, la journaliste de tradition réformée – qui a tiré de ses expériences un podcast pour Radio Fribourg – raconte quelques signes, «quelque chose de l’ordre du divin» qui s’est manifesté à plusieurs reprises, comme le retour du goût perdu du fait de la Covid-19 et une pomme tombée devant elle alors qu’elle avait faim. «Je crois que, quand on marche, on s’ouvre à Dieu et au ciel, remarque-t-elle avant de confier que sa foi s’est affermie. En marchant on s’engage à être une meilleure personne, à faire du bien aux autres et à soi. C’est en fait ce que doit faire tout croyant.»