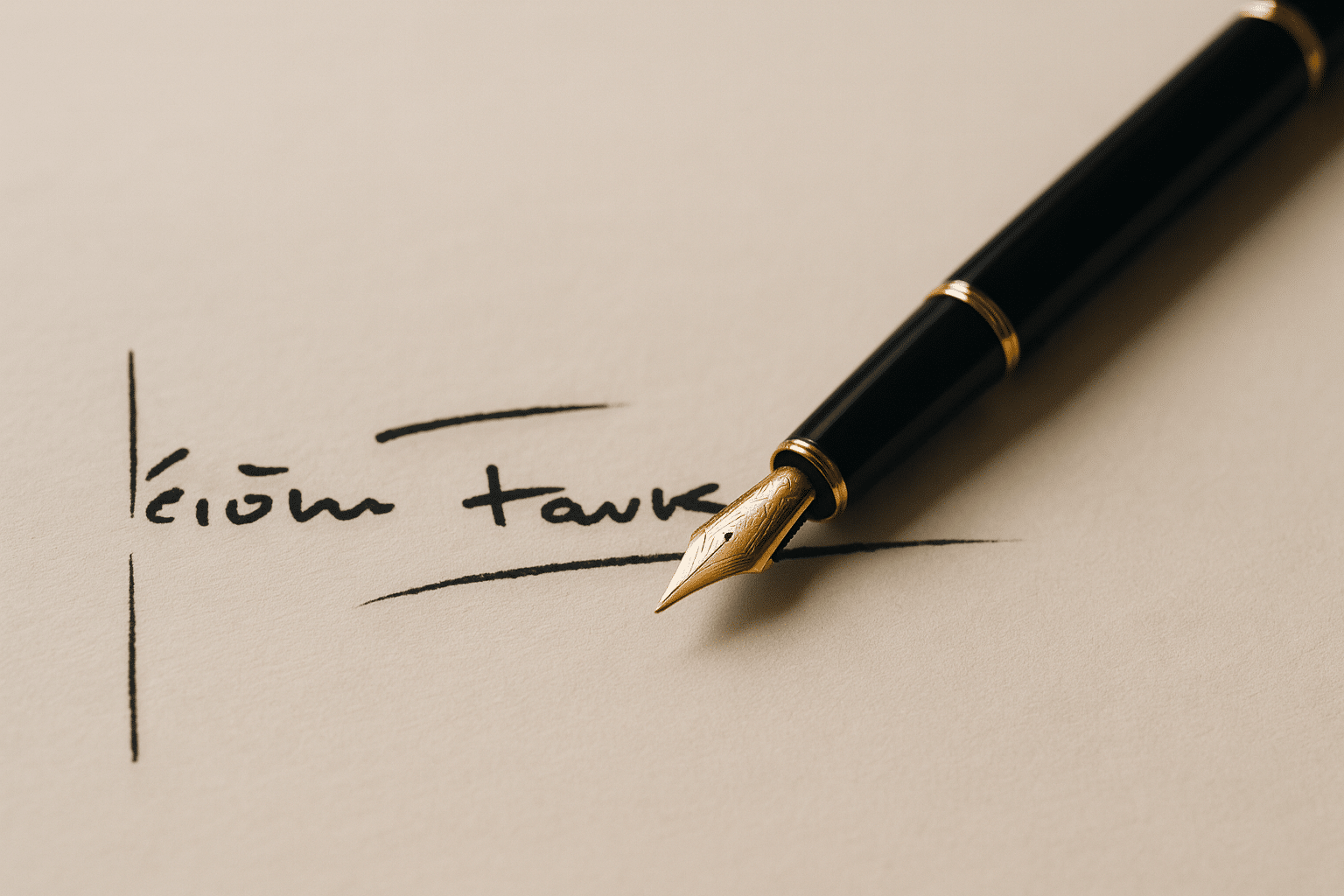A l’approche des fêtes et du Black Friday, la tentation du neuf s’intensifie. Pourtant, un mouvement discret gagne du terrain: celui qui invite à faire durer ce que l’on a déjà. Dans les ateliers et les lieux d’entraide, des acteurs s’engagent pour une autre façon de consommer.

«Ici, rien ne part à la poubelle sans qu’on ait essayé de le sauver», lance fièrement Olivier Lambiel en dégageant un coin de son établi. Dans son atelier de réparation à Chénens (FR), la lumière filtre par les grandes fenêtres du bâtiment de la gare où il est installé. Sur le plan de travail s’empilent des tournevis, des résistances, des plaques d’aluminium et une machine à café éventrée, prête à renaître. De temps à autre, un train file sur les rails tout proches, faisant frémir les vitres et ponctuant le travail du réparateur. Ancien mécanicien industriel, originaire du Valais, Olivier Lambiel a ouvert Self-Repair Lambiel en 2018. Il y répare des appareils électroménagers de toutes tailles, loue du matériel et vend des machines qu’il choisit pour leur robustesse. Il connaît chaque vis et chaque joint comme un médecin connaît les os du corps humain. «Ce que j’aime, c’est redonner vie à quelque chose qu’on croyait destiné à la déchetterie.» La philosophie de son atelier tient en une phrase: réparer plutôt que jeter. «J’explique souvent à mes clients qu’un appareil de qualité avec un entretien régulier selon mes recommandation peut durer beaucoup plus longtemps. A long terme, c’est même plus économique. Ce n’est pas qu’une question d’écologie, c’est une question de respect – du travail, de la matière, et de l’objet.»
Un artisan contre l’obsolescence
Son goût pour la durabilité lui vient de l’enfance: «J’ai grandi dans une famille modeste où on ne jetait rien. On apprenait à réparer, à bricoler, à prolonger. Aujourd’hui, tout est fait pour qu’on achète et qu’on jette, et qu’on ne puisse quasiment plus ouvrir un appareil, soupire-t-il. On met de l’électronique partout, soi-disant pour gagner en efficacité, mais ça complique tout et rend les objets moins durables».
Pourtant, depuis qu’il est installé dans le canton de Fribourg, le nombre de personnes faisant appel à ses services ne désenfle pas. Sa clientèle, souvent féminine d’âge moyen ou plus, vient chercher un service de confiance et de proximité. «On me dit souvent: ‘Je préfère que vous regardiez ma machine avant d’en acheter une autre’.»
Mais lorsqu’on évoque les repair cafés – un lieu où chacun peut réparer son objet cassé avec l’aide de bénévoles –, son sourire s’efface. «J’y ai participé plusieurs fois. J’y croyais, au début…» Mais il en garde un souvenir très mitigé. «Les gens ne jouent pas vraiment le jeu. Ils arrivent souvent avec des objets jetables», déplore le réparateur. Selon lui, le principe, pourtant noble, s’est retourné contre lui-même: «Au lieu de freiner la surconsommation, ça peut l’encourager. Ces lieux donnent bonne conscience à des comportements absurdes: acheter du bas de gamme en se disant qu’on trouvera toujours quelqu’un pour le rafistoler gratuitement».
Autre frustration: le manque de suivi. «Quand il faut uniquement commander une pièce, les gens ne reviennent jamais terminer la réparation. Ils veulent une solution immédiate, rapide et gratuite. Et quand ils voient que ce n’est pas possible, ils repartent acheter du jetable.» Déçu, le professionnel a fini par raccrocher son tablier de bénévole: «Je préfère consacrer mon énergie à ceux qui veulent vraiment faire durer leurs objets». Ces critiques, Diane Golay, responsable terrain et notamment responsable des repair cafés à la Fédération romande des consommateurs (FRC), les entend mais ne les partage pas. «Honnêtement, je n’ai jamais eu ce genre de retours, répond-elle calmement. L’expérience montre que cela dépend grandement de la régularité. Là où il y a un repair café tous les mois, les gens reviennent pour finir leurs réparations. Mais quand il n’y en a qu’un ou deux par an, comme c’est le cas dans certaines communes, c’est plus compliqué.»
Des repair cafés qui divisent
Le concept, né aux Pays-Bas en 2008, a été importé pour la première fois en Suisse en 2013 avec l’impulsion de la FRC. «Depuis, on aide les communes, les associations ou les particuliers qui veulent en créer.» Sur le site de la FRC, un guide complet attend les futurs organisateurs: marche à suivre, retroplanning, conseils, etc. La communication, c’est la FRC qui s’en charge. La fédération prend entièrement à sa charge l’impression des affiches et offre également une couverture d’assurance pour le jour de l’événement.
La diversité du public lors de ces journées est grande: des étudiants, des retraités, des familles. «Ce qui me frappe c’est la bonne humeur. Les bénévoles sont parfois d’anciens professionnels, mais peuvent également être de simples bricoleurs passionnés qui souhaitent partager. Et quand ils ne peuvent pas réparer, ils orientent les intéressés vers des réparateurs indépendants. Il y a une vraie complémentarité entre les deux mondes.»
Diane Golay balaie aussi l’idée d’une concurrence déloyale avec les artisans: «Les repair cafés ne vendent rien. Ils facturent simplement les éventuelles pièces de remplacement, mais jamais la main d’œuvre. Ces évènements créent avant tout du lien et réhabilitent l’envie de réparer». Selon elle, un vrai problème se situe toutefois ailleurs: dans la logique industrielle. «La FRC a mené une enquête il y a quelques années. Nos testeurs ont apporté à de grandes enseignes des appareils présentant des pannes courantes. Le résultat est plutôt triste: la réparation n’est pas du tout une option dans l’immense majorité des cas. Le droit suisse n’oblige d’ailleurs pas les vendeurs à réparer un appareil sous garantie si le client le demande; ils peuvent choisir entre remplacement, remboursement et réparation.»
Changer les habitudes

Pour Marlyne Sahakian, professeure associée en sociologie à l’Université de Genève et spécialiste de la consommation durable, ces débats illustrent un changement plus profond: «Nous vivons dans une throwaway society – la société du tout-jetable». La chercheuse observe depuis vingt ans la manière dont nos sociétés consomment et rejettent. «La réparation et le partage d’objets ont toujours existé. Mais l’obsolescence programmée et la culture du jetable les ont marginalisés. Aujourd’hui, on les redécouvre à travers les repair cafés, les bibliothèques d’objets ou les ateliers collaboratifs.»
La chercheuse mentionne aussi la dimension du temps, également évoquée par Olivier Lambiel: «Nous vivons également dans une société de la commodité où tout doit être rapide et pratique. Prendre le temps de réparer, d’attendre une pièce, c’est presque un luxe pour certaines personnes». Et elle ajoute qu’il «faut cesser de tout faire peser sur les individus. Depuis des décennies, on sur-individualise la responsabilité. On fait croire que les consommateurs peuvent, à eux seuls, changer le système. Or, les entreprises et les intermédiaires ont un rôle majeur à jouer». Elle évoque et salue l’initiative d’une régie d’habitation genevoise qui offre à ses nouveaux locataires un mois d’abonnement à la Manivelle, une bibliothèque d’objets. Un petit geste, mais un signal fort: «C’est ce genre d’initiative qui peut vraiment faciliter un changement de pratiques».
Derrière les tournevis et les écrous, c’est aussi une autre idée, plus sociale, du monde qui se joue. «Ces démarches ne font pas seulement sens sur le plan écologique ou économique, insiste Marlyne Sahakian. Réparer ensemble, c’est aussi retisser des relations humaines.» Dans l’atelier d’Olivier Lambiel comme dans les repair cafés qu’il a quittés, une même conviction subsiste: il est encore très souvent possible de réparer ce qui semble cassé.
Mieux consommer
Et la sociologue veut croire que cette énergie collective est porteuse d’avenir: «Peut-être allons-nous revenir vers le goût du vieux, du vintage, vers une culture du réemploi et de la réparation. Je vois émerger une réflexion forte sur la sobriété et la suffisance. Il ne s’agit plus seulement de consommer moins, mais de se demander ce que cela veut dire de consommer mieux. Les changements sont lents. Mais ils existent. Et cela, c’est déjà une bonne nouvelle».