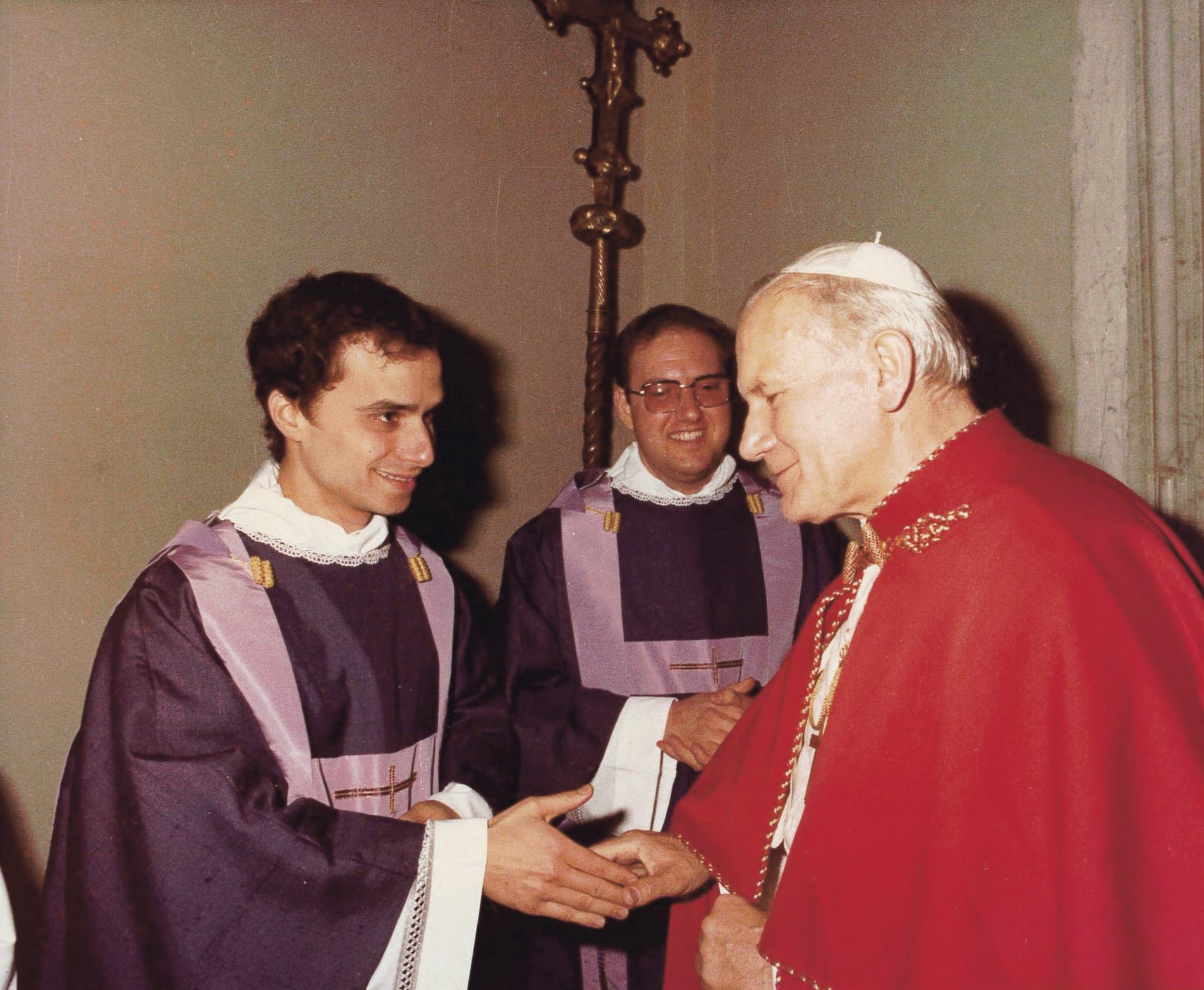Une présence, une main sur l’épaule, une verrée après des funérailles: un décès peut être l’occasion de réunir une communauté autour des personnes endeuillées. Mais celles-ci se retrouvent souvent isolées après quelques semaines ou mois, le deuil étant vu comme un processus limité dans le temps.

«J’avais l’impression d’être à la maison, je retrouvais la communauté de mon enfance.» Florentine*, jeune retraitée valaisanne, a enterré sa mère il y a huit ans et son père il y a trois ans. Les funérailles ont à chaque fois été célébrées dans la petite église du village où ils vivaient et où elle a grandi, lui permettant de retrouver nombre de connaissances, que ce soit lors de la cérémonie ou lors d’un moment de veille le soir précédent. «C’était réconfortant», ajoute cette catholique pratiquante.
«La communauté joue un rôle et la participation est toujours importante lors de funérailles. L’idée reste que c’est l’un des nôtres qui est décédé», constate, dans le Jura, Marie-Josèphe La-chat, théologienne en pastorale qui vit sa retraite de manière active. C’est une affection qui est témoignée au défunt, un soutien à la famille. Que celle-ci participe de manière active à la vie de la paroisse ou qu’elle se soit éloignée de la religion. «La communauté de foi montre qu’elle se soucie de ces personnes. Elle partage leur souffrance, pas uniquement par des mots sur une carte de deuil, mais de manière personnelle par sa présence, par un geste.»
La communauté demeure
Le deuil a pourtant perdu de son caractère communautaire au fil du temps. Les signes clairs, comme un brassard ou un bouton noir au veston ne se portent plus. «Cela attirait l’attention de la communauté sur la fragilité de ceux qui les arboraient.»
Chargée de recherche auprès de la Haute école de travail social et de la santé à Lausanne, Aurélie Jung s’est intéressée dans sa thèse de doctorat défendue à l’Université de Genève à l’évolution de l’accompagnement du deuil depuis le 19e siècle. La communauté a perdu en importance et une partie de ses fonctions. «Certaines tâches qui s’effectuaient au sein de la famille ou de la communauté, comme le soin et la veille du corps, ont été transférées à des professionnels. L’accompagnement des endeuillés a ainsi perdu de son caractère public», analyse la sociologue.
Elle apporte toutefois une nuance: la technologie a provoqué un transfert, ou un changement dans le concept de communauté. «L’aspect social s’est déplacé sur les réseaux sociaux où on peut chercher du soutien en ligne ou exprimer sa sympathie, ce qu’on fait moins que par le passé à l’église.» Force est de reconnaître que l’apport de la communauté n’est pas toujours recherché, comme en témoigne la multiplication des funérailles célébrées dans l’intimité. Celles-ci peuvent exprimer la volonté du défunt ou la gêne de la famille face à une ritualité pas toujours bien connue.

Pasteure à Neuchâtel, Carmen Burkhalter a plusieurs fois reçu la demande «de ne pas trop parler de Dieu. Cela arrive par exemple lorsque le défunt était croyant, mais pas la famille». Elle explique alors quel est son rôle lors du service funéraire, qu’elle mène «au nom du Dieu auquel je crois et qui nous a promis quelque chose qui concerne aussi le défunt: la mort n’est pas le dernier mot».
La communauté de foi donne «un signe d’espérance», acquiesce Marie-Josèphe Lachat. Les cérémonies laïques sont davantage tournées vers le défunt auquel on rend hommage, les cérémonies religieuses ouvrent à une autre dimension. Qui peut être consolatrice, même si, «attention, il ne s’agit pas de secouer les personnes endeuillées en leur disant de penser à la résurrection». Carmen Burkhalter, qui est aussi aumônière dans un home, un hôpital et un établissement psychiatrique, ne dit pas autre chose en insistant sur l’écoute accordée aux endeuillés. «Répéter que la foi aide à supporter les choses, est-ce que ça console? C’est peut-être dit avec la meilleure volonté du monde, mais c’est une consolation un peu rapide…»
La faute à Kübler-Ross
Certaines phrases témoignent davantage de la gêne de ceux qui entourent la personne endeuillée, suspecte la pasteure. D’autant que chacun a son idée de la façon de faire son deuil… et du temps qu’il doit durer. Bien soutenue par son employeur, une administration communale qui lui a permis de prendre le temps nécessaire entre les décès et les funérailles, Florentine* a constaté que le souci passait rapidement. «Avec mes amies les plus proches je pouvais continuer d’en parler, mais au travail, ce n’était rapidement plus un sujet. Chacun retourne à ses activités et on s’entend dire que la vie continue. C’est une phrase horrible à entendre», explique la Valaisanne dont la voix se noue lorsque, dans la conversation, elle évoque son frère décédé il y a près de quarante ans.
N’aurait-elle toujours pas fait son deuil, comme on dit? «C’est une idée dépassée: un deuil impacte une vie entière. Il doit se penser sur un temps très long», répond Aurélie Jung. Le temps du deuil, dit-elle-même, c’est toute la vie. Or, depuis les années 1960 et les travaux de la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross, on pense le deuil comme un travail à mener sous forme d’étapes. Un processus linéaire censé être limité dans le temps: «La médecine estime que le deuil est pathologique si les symptômes comme la perte de sommeil et la dépression perdurent au-delà d’une année et qu’il faut alors une prise en charge médicale».
Après quelques mois, le deuil devrait donc être «fait», c’est ce qui est par exemple escompté sur le lieu de travail. Où la personne en deuil bénéficie en principe d’un, deux ou trois jours de congé en fonction du rapport de parenté. Outre que ces jours sont surtout pris par des préoccupations organisationnelles, ils ne tiennent pas compte du lien entre le disparu et l’employé: «Si vous perdez votre meilleur ami que vous connaissez depuis trente ans, rien n’est prévu», remarque la sociologue qui a contribué à l’élaboration d’un guide pour les entreprises. Dans lesquelles on attend que l’endeuillé retrouve rapidement son rythme de travail habituel. «Sans quoi on est emprunté et, après un certain temps, on propose un congé maladie. Mais le deuil n’est pas une maladie», souligne la spécialiste.
L’idée que le chagrin est apaisé en quel-ques étapes est tellement gravée dans les esprits – confortée par ce que l’on trouve sur internet en cherchant comment affronter son deuil – que certains en viennent à s’inquiéter de ne pas faire leur deuil correctement. Aurélie Jung rapporte le témoignage d’une personne ayant consulté un médecin parce qu’elle n’était pas passée par l’étape de la colère, ce qui ne pouvait à ses yeux pas être normal. A cela s’ajoute que ces théories ont fait du deuil un processus individuel. Ce qui peut aussi expliquer l’absence de questions des proches après un certain temps, avec la peur de raviver une blessure qu’on suppose en voie de cicatrisation ou cicatrisée.
«DIEU A LES ÉPAULES ASSEZ LARGES»
La foi est-elle une consolation face à la mort? «Ce n’est pas un pansement ni un parapluie qui nous protège de tout», glisse la pasteure Carmen Burkhalter lorsqu’on évoque avec elle le scandale de la mort. Si elle a été confrontée au suicide de patients de l’établissement psychiatrique dans lequel elle est aumônière, elle n’a jamais a eu à mener de service funéraire pour un enfant. «Je ne sais pas comment je réagirais, mais je pense que je pourrais laisser de la place à la révolte, aux larmes, un moment pour dire que c’est inacceptable.»
Maintenir le contact
La mort est toujours terrible, complète Marie-Josèphe Lachat en parlant des larmes de petits enfants vivant leur premier deuil. Dans son accompagnement, elle pousse même les proches d’un défunt «à en vouloir au Bon Dieu». C’est une façon de maintenir le contact avec lui avant un apaisement, comme dans les psaumes où la révolte s’épuise avant que Dieu ne réponde. Dieu «se laisse prendre comme bouc émissaire. Il a les épaules assez larges». Et il ne nous abandonne pas, insiste la théologienne catholique en rappelant que, lui-même scandalisé par la mort, l’a traversée.
Le besoin de parler
Dans les communautés paroissiales, on essaie de proposer un accompagnement dans un temps plus ou moins long. Dans les semaines qui suivent un service funéraire, Carmen Burkhalter reprend contact avec la famille. «C’est l’occasion d’une visite, de voir comment les choses se passent», raconte la pasteure neuchâteloise qui n’officie plus en paroisse mais loue les «initiatives formidables» que prennent certaines d’entre elles, adressant un signe – sous la forme d’un message ou d’une rose – aux proches un an après un décès. Le début novembre peut aussi être, dans le monde protestant, l’occasion d’un culte du souvenir.
Dans l’espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs, Marie-Josèphe Lachat a œuvré à la formation d’équipes d’accompagnement des funérailles, voulues par le conseil pastoral du Jura pastoral. Avec l’idée de donner «un signe de l’accompagnement de la communauté», de la préparation des funérailles à la messe de premier anniversaire du décès où la participation est plus importante que lors des autres messes. De telles attentions, après une ou plusieurs années d’ailleurs, sont encore courantes – un coup d’œil au tableau d’affichage de l’église de Martigny (VS) permettait par exemple d’en compter six en une semaine à la mi-octobre.
La commémoration des fidèles défunts le 2 novembre est, pour les catholiques, l’occasion de faire mémoire des disparus dans le temps long. Et l’accompagnement peut se prolonger, ajoute Marie-Josèphe Lachat, de manière indirecte avec la communion à domicile demandée par des personnes âgés. «Ces visites sont précieuses et permettent un bel accompagnement dans la durée, l’espérance et l’attention. Le deuil n’est pas primordial dans ces rencontres, mais c’est une opportunité d’en parler une fois par mois.»
En parler. Ce besoin qui peut de moins en moins être satisfait avec le temps est important. Pour Florentine* comme pour beaucoup d’autres: «Parler des défunts c’est les faire exister encore. C’est d’autant plus tragique de ne plus pouvoir parler d’eux».
* Prénom d’emprunt