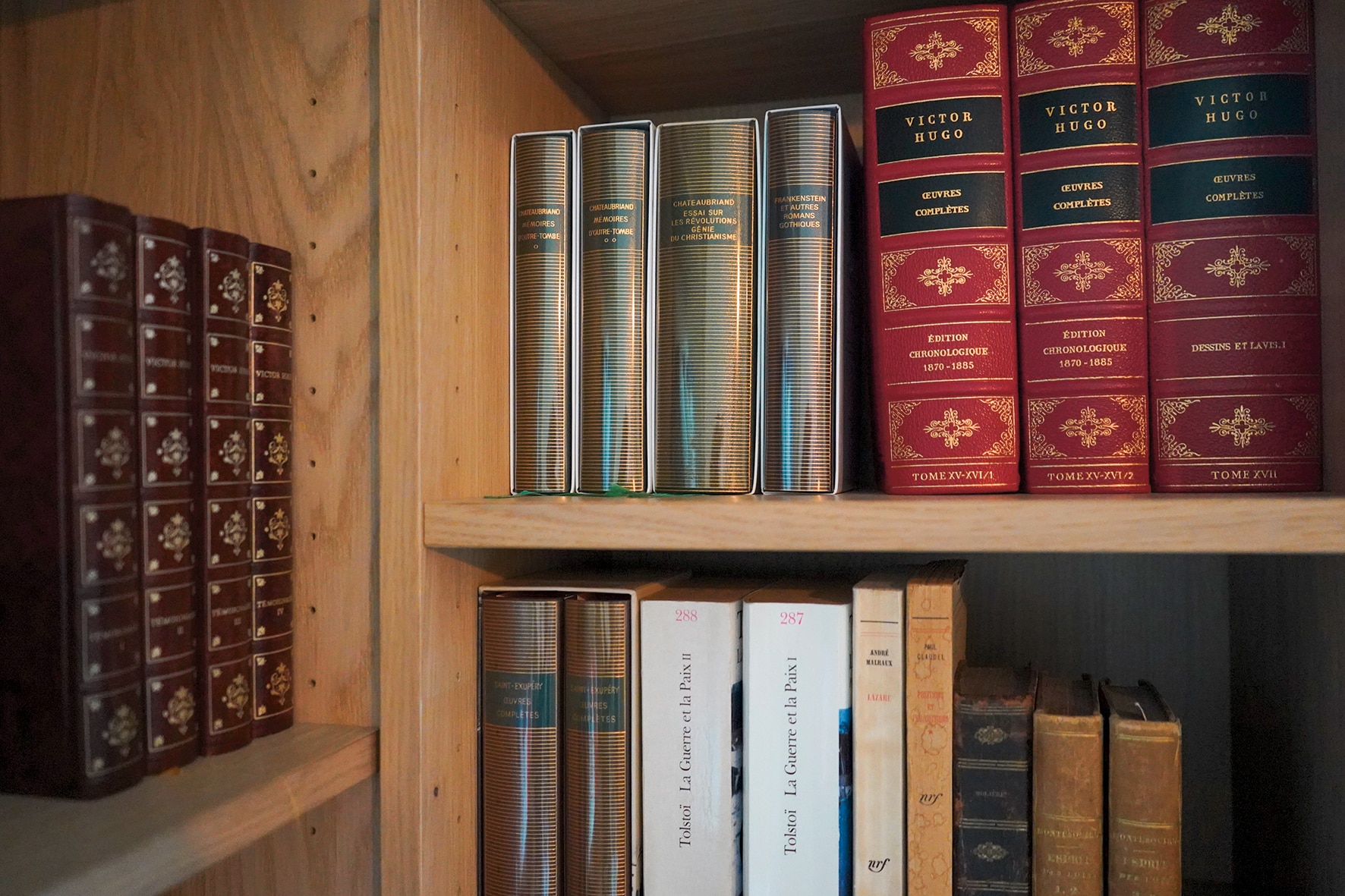En Suisse romande, les fêtes florales traditionnelles peinent à perdurer face aux défis économiques et écologiques. Certaines disparaissent, d’autres se réinventent, alliant désormais émerveillement, pédagogie et responsabilité environnementale.

Sous les premiers rayons dusoleil printanier, des visiteurs de tous âges déambulent. Smartphone en main et sourire aux lèvres, prêts à capturer le spectacle coloré qui s’offre à eux. A Morges (VD), la Fête de la tulipe attire chaque année des milliers de curieux venant admirer ces massifs fleuris. Pourtant, si cette tradition populaire perdure avec succès au bord du Léman, ailleurs en Suisse, plusieurs grandes fêtes florales se fanent progressivement, confrontées à des défis économiques, humains et environnementaux.
Le bruissement d’une brise entre des allées de tulipes, le chatoiement des couleurs sous un ciel de fin d’avril, le crissement d’un sac en papier emportant quelques bulbes… Tout cela, la Fête de la tulipe à Morges continue de l’offrir aux touristes et nombreux habitués. «Plus de 300’000 visiteurs viennent s’émerveiller devant nos tulipes chaque année. Un besoin vital de beauté et de nature exacerbé par le semi-confinement en 2020», détaille Hélène Pageaud, cheffe de projet «Fête de la tulipe» pour l’association Morges Fleur du Léman.
Palexpo en fleurs
Le tumulte des préparatifs, les impressionnantes mosaïcultures, les odeurs entêtantes d’engrais naturel – ces sensations des Floralies internationales de Genève ont été balayées par les réalités modernes. Car aujourd’hui, cet évènement incontournable de l’agenda culturel genevois n’est plus qu’un souvenir.
A l’origine, les Floralies naissent d’une volonté d’affirmer la richesse horticole d’un territoire, de séduire et d’instruire. Inspirées par les expositions universelles du 19e siècle, elles mêlaient art des jardins, nouvelles variétés botaniques et prouesses d’aménagement. Dès 1883, Gand en Belgique montrait l’exemple, bientôt suivi par Nantes, Paris et Genève pour une édition unique en 1956.

Quarante ans plus tard, en 1996, les Floralies internationales de Genève sont de retour, dans les halles de Palexpo cette fois-ci. Tous les trois ans jusqu’en 2008, l’exposition est intégrée à la Foire de Genève comme un moyen d’attirer plus de visiteurs. Luc Eric Revilliod, ancien responsable technique de l’évènement, se souvient: «Les Floralies étaient certes une vitrine éblouissante, mais financièrement, leur coût – proche du million de francs – était devenu insoutenable». Et cela même si les expositions attiraient des centaines de milliers de visiteurs à chaque édition.
A Nyon (VD), Jean-Luc Pasquier, président du Concours international de la rose nouvelle (CIRNN), a connu une autre forme d’érosion: celle du tissu humain. «Aujourd’hui, le bénévolat s’effrite. Personne n’est prêt à donner 300 heures de son temps par an, même pour un projet prestigieux comme le CIRNN», confie-t-il. Ce chiffre effarant laisse imaginer les innombrables heures de travail patient, les mains écorchées par les épines, les bras las de porter des caissettes de jeunes plants. Devant la réalité crue, la passion seule ne suffit plus.
Les mécènes se font rares et les élus hésitent à allouer des budgets à ces évènements dont la fleur est le centre. Ici et là, même si l’amour pour la nature ne faiblit pas, des concours ferment et des associations disparaissent.
S’ajoutent à cela des pressions environnementales croissantes. Les floraisons généreuses sont scrutées d’un œil suspicieux par le public et les médias: combien de tonnes d’eau? Combien de pesticides? «Nous avions fait le choix dès le début d’un concours zéro traitement pour montrer qu’une roseraie peut fleurir sans chimie et pour répondre aux défis écologiques de demain», souligne Jean-Luc Pasquier.
Malgré cet intérêt pour une culture durable et respectueuse des ressources comme l’eau, parfaitement aligné avec les préoccupations actuelles relatives au changement climatique, le CIRNN n’est pas parvenu à trouver de nouveaux acteurs pour prendre la relève. L’édition 2025 qui aura lieu cet automne sera donc la dernière à Nyon.
Des Floralies 2.0
Ailleurs, on tente de faire évoluer les formes. A Palexpo, la fondation Hortus souhaite remettre au goût du jour le concept de Floralies à travers le Green City Festival. «Relancer une fête florale aujourd’hui est impossible sans avoir à tout repenser. Les Floralies 2.0 doivent parler écologie, ville verte et gestion de l’eau», explique avec enthousiasme le directeur de la fondation, Philippe Kaspar. Ici, et contrairement à autrefois, les massifs n’auront plus pour seule ambition d’émerveiller.

Avec cet évènement qui prendra place dans les grandes halles genevoises lors des prochaines Automnales, Philippe Kaspar souhaite «éduquer en émerveillant» ou inspirer. Une mission modeste, mais précieuse, à l’heure où la nature reprend doucement ses droits dans les interstices de nos villes. Le visiteur pourra ainsi découvrir comment une toiture végétalisée rafraîchit une ville, comment un bassin de rétention peut prévenir les inondations, comment les haies diversifiées abritent une faune précieuse.
Egalement organisé par la fondation Hortus, le Garden Festival s’est tenu au château de Coppet (VD) le premier week-end de mai. Un autre évènement qui incarne cette nouvelle approche. Comme pour toutes les fêtes et tous les concours floraux, les visiteurs circulent entre des expositions éphémères. Mais ici, contrairement à l’usage, point de gaspillage. «On veut sortir du modèle consumériste; nos plantes sont exposées, puis replantées. Rien n’est gaspillé », affirme l’organisateur.
Morges et ses bulbes

Dans le parc de l’Indépendance à Morges, la conscience écologique est aussi présente, mais sans ostentation: «Nous faisons tout pour limiter notre impact», assure Hélène Pageaud. Dans les allées, on entend les voix s’élever: «Celui-ci, c’est pour le parterre devant la maison», «On en prend pour mamie aussi?». Après la fête, les bulbes importés de Hollande sont vendus à petit prix, permettant aux visiteurs d’emporter chez eux un fragment de ce printemps enchanté tout en faisant rentrer de l’argent dans les caisses. Une somme toutefois non négligeable qui permet à l’évènement iconique de la région d’être de retour chaque printemps.
Dans ce parc au bord du lac, les senteurs poivrées des tulipes s’élèvent dans l’air doux. Les enfants courent entre les massifs, leurs rires se mêlant au clapotis du Léman tout proche. Les parents posent pour des photos souvenir devant les massifs. Mais ici, pas de billet d’entrée à brandir: «Notre fête est gratuite, associative et populaire: c’est probablement ce qui nous protège de l’essoufflement qu’ont connu d’autres événements», conclut-elle.
Un changement de dynamique
Aujourd’hui, loin des fastes éphémères d’antan, c’est une véritable métamorphose que vivent les fêtes florales romandes. Si certaines disparaissent, incapables de répondre aux nouvelles réalités économiques et écologiques, d’autres évoluent avec leur époque, privilégiant désormais la pérennité et l’engagement citoyen.
On voit ainsi émerger partout en Suisse des jardins participatifs où chacun vient cultiver légumes, fleurs et convivialité. Des micro-forêts urbaines poussent silencieusement dans les quartiers bétonnés, apportant fraîcheur et biodiversité. Les parcs pédagogiques se multiplient, sensibilisant dès le plus jeune âge aux enjeux climatiques et à l’importance de la nature en ville. Plus qu’un décor vivant, les fleurs et plantes deviennent de véritables ambassadrices d’un futur plus vert et plus responsable.
L’essor de ces nouvelles pratiques souligne une prise de conscience collective: l’émerveillement ne suffit plus, il doit désormais s’accompagner d’une démarche durable, utile, et accessible à tous. Ainsi, même si les grandes floralies d’autrefois appartiennent en grande partie à la mémoire collective, elles continuent d’inspirer de nouvelles générations d’amoureux de la nature décidés à préserver autrement ce lien vital entre l’humain et son environnement.