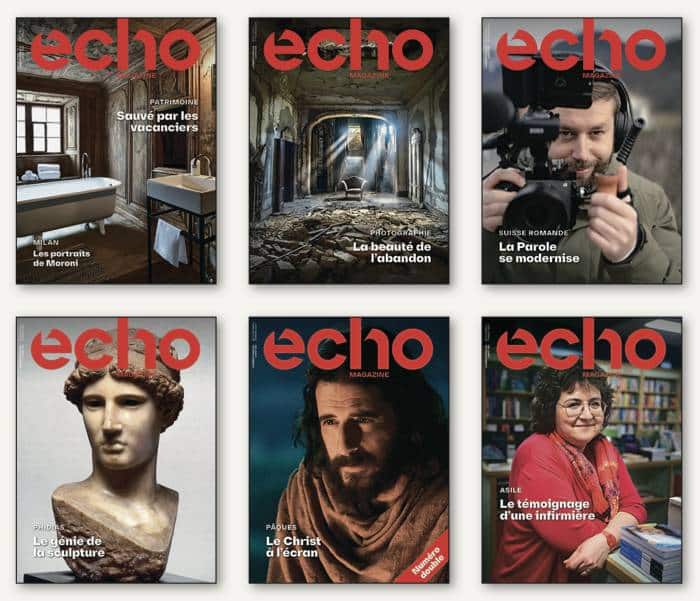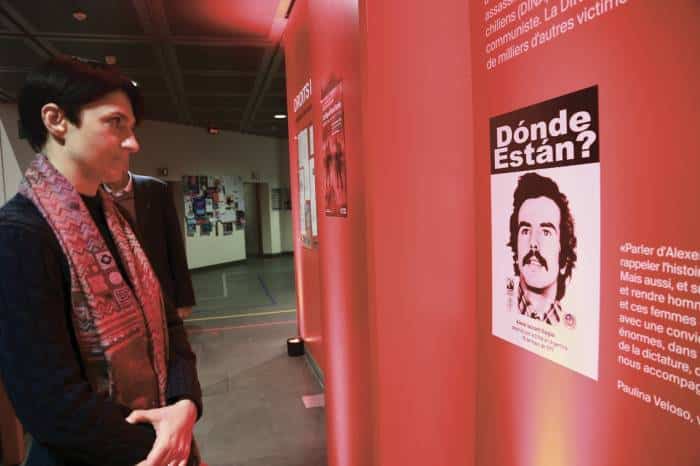Catholiques, orthodoxes et protestants fêteront ensemble la résurrection du Christ le 20 avril. Une coïncidence calendaire peu fréquente qui tombe, de surcroît, l’année du 1700e anniversaire du concile de Nicée. Suffisant pour espérer une fête de Pâques commune chaque année? Pas si simple.

«La fête de Pâques, c’est le cœur de la foi, affirme l’archiprêtre de l’Eglise russe de Genève Emilien Pochinok. Sans la résurrection, la foi chrétienne n’a plus vraiment de raison d’être. Pour nous, orthodoxes, c’est la fête numéro un, bien au-dessus de Noël.» Peu de théologiens contrediront cette affirmation. La résurrection est au centre de la foi chrétienne. Pourtant, pour beaucoup, c’est Noël qui occupe la première place.
L’historien Frédéric Amsler, spécialiste du christianisme primitif à l’Université de Lausanne, y voit un glissement culturel. «Dans le monde orthodoxe, Pâques reste la fête centrale. Dans la société occidentale, Noël a progressivement pris le dessus, ce que beaucoup d’orthodoxes considèrent comme une déviation.» Ce contraste souligne la diversité des manières de vivre et de célébrer la foi.
Une convergence rare, mais précieuse
Tous les chrétiens commémorent le même événement, mais pas toujours le même jour. Cette année pourtant, «c’est une double joie, de pouvoir entendre les cloches sonner à l’unisson, de partager la même allégresse avec les catholiques et les protestants», se réjouit le père Pochinok. Une joie rare: cette simultanéité reste exceptionnelle.
Pour Mgr Etienne Vetö, membre de la Commission théologique internationale, une date commune aurait un impact sur «le regard qui se pose sur l’Eglise». Dans un entretien accordé à Vatican News, il explique que ce serait un signe très fort d’unité autour de l’essentiel: la résurrection du Christ. Cette convergence ne ferait pas disparaître les différences doctrinales, mais rendrait visible ce qui unit tous les baptisés. Pour Mgr Vetö, les divergences actuelles font même office de «contre-témoignage».
Le cœur du désaccord? Le calendrier. «La différence entre les calendriers julien et grégorien explique à elle seule le décalage des dates», résume Frédéric Amsler. Le calendrier grégorien, introduit au 16e siècle, n’a jamais été adopté par les Eglises orthodoxes pour les fêtes mobiles. Mais la question est plus ancienne. Dès les premiers siècles, certaines Eglises célébraient la résurrection à date fixe, d’autres uniquement un dimanche.
Politique et théologie
Le concile de Nicée, en 325, tranche: Pâques sera célébré le dimanche suivant la première pleine lune après l’équinoxe de printemps. Mais les calculs diffèrent encore. Certains se fient à un cycle ecclésiastique traditionnel, d’autres à l’astronomie. Résultat: des dates souvent différentes.

«Le rêve d’unité liturgique me paraît peu réaliste»
-Frédéric Amsler
Cette divergence n’est pas qu’un détail technique. Elle touche à l’histoire même de l’unité chrétienne. «Constantin voulait unifier l’Empire par un socle religieux partagé. L’unité doctrinale était aussi une unité politique», rappelle Frédéric Amsler. Dès l’origine, la fixation d’une date commune relevait autant du spirituel que du politique.
Et aujourd’hui? Le pape François a réaffirmé son souhait d’une célébration commune. Le 19 septembre dernier, il appelait à ne pas «laisser passer en vain l’importante opportunité que nous offre 2025». Il encourageait les Eglises à poursuivre leurs efforts, rappelant que «la Pâque est celle du Christ» et qu’il faut éviter «de nouvelles divisions entre frères». Mais un large consensus reste indispensable. «Des synodes sont nécessaires», souligne le Père Pochinok.
Une prudence compréhensible, tant l’attachement aux traditions reste fort. «Chaque année, le jour de la Pâque orthodoxe, un feu sacré jaillit du tombeau du Christ à Jérusalem, rappelle l’archiprêtre. C’est un miracle qui renforce notre foi dans la date précise à laquelle nous célébrons Pâques.»
Entre unité visible et diversité assumée
Faut-il alors continuer d’espérer? «Le rêve d’unité liturgique me paraît peu réaliste, confie Frédéric Amsler. L’histoire du christianisme est une histoire de différences de sensibilités, de langues, de cultures. Vouloir les uniformiser, c’est oublier que le pluralisme peut aussi être une richesse.» Et de rappeler que «chaque concile, ou presque, s’est soldé par des divisions, car, avec les anathèmes, c’est aussi un outil d’exclusion. Ce n’est peut-être pas la meilleure méthode pour construire l’unité».
Reste que la convergence de 2025 ne constitue qu’un épisode isolé. Depuis le début du siècle, catholiques et orthodoxes n’ont fêté Pâques à la même date que quatre fois: en 2001, 2004, 2007 et 2010. Celle du 20 avril sera la cinquième. La prochaine n’est pas attendue avant 2034. Il ne s’agit pas d’une célébration commune au sens liturgique ou œcuménique, mais d’une simultanéité vécue dans chaque tradition.
Faut-il pour autant en minimiser la portée? Pour Mgr Etienne Vetö, cette simultanéité, même sans unité institutionnelle, garde une valeur symbolique forte. Elle rappelle que l’essentiel de la foi chrétienne est commun et qu’un tel alignement peut rendre plus visible, aux yeux du monde, ce qui unit les croyants. Dans un contexte de sécularisation accélérée, où les Eglises sont souvent appelées à s’exprimer ensemble sur des enjeux profonds, cette convergence offre un terrain propice à la reconnaissance mutuelle, au dialogue et, peut-être, à un témoignage plus audible dans l’espace public.